Rubriques tendance
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
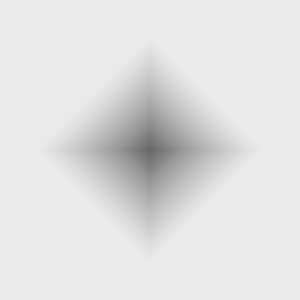
896622
Cet essai examine le statut des virus par rapport aux critères de la vie, en intégrant à la fois des preuves scientifiques et des réflexions philosophiques. Malgré leurs interactions significatives avec les systèmes biologiques et les controverses concernant cette position, selon ma définition, les virus ne répondent pas aux critères biologiques fondamentaux de la vie. Ils dépendent entièrement de la machinerie cellulaire de l'hôte pour se répliquer et manquent à la fois de métabolisme autonome et de structure cellulaire. Cette analyse s'aligne avec le consensus scientifique plus large et les considérations philosophiques selon lesquelles les virus ne devraient pas être classés comme des organismes vivants et les implications de cette hypothèse.
« Comment l'organisme vivant évite-t-il la décomposition ? La réponse évidente est : en mangeant, en buvant, en respirant et (dans le cas des plantes) en assimilant. Le terme technique est métabolisme. Le mot grec () signifie changement ou échange. Échange de quoi ? » ― Erwin Schrödinger, Qu'est-ce que la vie ?, l'homme qui a prédit l'ADN des décennies avant sa découverte, et un non-biologiste objectif.
Introduction
La nature de la vie a longtemps été un sujet d'enquête philosophique et scientifique. Les virus, qui utilisent la machinerie cellulaire de l'hôte pour se répliquer sans métabolisme autonome ni structure cellulaire, remettent en question les définitions traditionnelles de la vie biologique mais ne les satisfont pas. Les perspectives historiques ont fluctué, plaçant souvent les virus dans une zone grise entre la vie et la non-vie. Cependant, le consensus, basé sur la compréhension actuelle, place fermement les virus en dehors du domaine des organismes vivants (Moreira & Lopez-Garcia, 2009 ; Lederberg, 2002).
Les virus n'ont pas de métabolisme intrinsèque. Ils entrent, bien sûr, dans les cellules, et les cellules métabolisent, et on peut dire que les virus sont alors vivants, comme une graine dans un sol fertile. Cependant, une graine maintient un état métabolique faible mais existant, tandis qu'un morceau de pain—ou un virus—ne le fait pas. La différence matérielle, bien sûr, est que les virus contiennent des informations génétiques, qui peuvent se répliquer à l'intérieur d'une cellule, nous faisant initialement les imaginer comme analogues aux bactéries. Mais ils ressemblent davantage à une nanoparticule lipidique de vaccin à ARNm qu'à une bactérie, puisque la bactérie a un métabolisme actif et auto-régulateur, et le virus n'en a pas.
La question de savoir si les virus sont vivants a été un sujet de débat, tant sur le plan scientifique que philosophique. Norman Pirie a un jour fait remarquer que définir la vie devient nécessaire à mesure que nous découvrons des entités qui ne sont clairement ni vivantes ni mortes (Villarreal, 2004). Les virus, existant à la frontière entre la chimie et la vie, se répliquent à l'intérieur des cellules hôtes, remettant en question notre compréhension de ce que signifie être 'vivant'.
Ces comportements, cependant, ne confèrent pas l'autonomie qui est une caractéristique de la vie. Ce qui ne peut jamais être vivant en dehors d'un organisme vivant, et cesse son activité en le quittant, ne peut pas métaboliser, comme l'a souligné Schrödinger. Je pourrais voir la vie comme des atomes avec des électrons les entourant, ce que nous appelons la matière. Mais alors je ne saurais pas ce qui est physique et ce qui est biologique. Je pourrais être piégé dans des problèmes sans fin, élargissant les horizons pour inclure la vie non-terrestre ou des phénomènes inconnus. Je pourrais créer des possibilités illimitées—univers, totalité, conscience—me rendant à des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Ce n'est pas de la lâcheté de renoncer à cela ; c'est plutôt pratique de se concentrer sur ce qui peut être étudié et corroboré par des preuves. Je pourrais devenir philosophe, penser à la vie et à la non-vie comme à l'entropie, ou étudier des phénomènes quantiques. Ou je pourrais faire le travail du biologiste.
L'étude de la vie, ambitieuse mais limitée, nécessite des définitions de travail. Les biologistes ont créé des critères, des taxonomies et des théories évolutives, les affinant au fil des siècles. Ces cadres tiennent bien pour la vie cellulaire, cartographiant les gènes et les relations évolutives dans un Arbre de la Vie. Ajouter des virus à cet arbre le fait s'effondrer, car les virus manquent des caractéristiques autonomes qui s'intègrent dans ces définitions. Ils ne se placent pas logiquement, sémantiquement ou computationnellement dans ce système.
Cette discussion fusionne des enquêtes philosophiques profondes avec des recherches empiriques. La distinction entre les entités qui peuvent se répliquer, métaboliser et maintenir l'homéostasie de manière autonome, et celles qui ne le peuvent pas—comme les virus—soutient une nature binaire de la vie. Cette perspective est renforcée par la nécessité d'une structure cellulaire pour une vie autonome stable (Sinha et al., 2017 ; Braga et al., 2018). Philosophiquement, les virus remettent en question notre compréhension des définitions de la vie. Certains décrivent leur réplication à l'intérieur des cellules comme une "sorte de vie empruntée" (Villarreal, 2004). Pourtant, puisqu'ils dépendent entièrement de la machinerie métabolique de l'hôte, ils sont plus semblables à des agents biologiques qu'à des organismes vivants indépendants.
Comme l'a souligné le lauréat du prix Nobel Joshua Lederberg, les virus s'entrelacent profondément avec la génétique et le métabolisme de l'hôte, influençant l'évolution sans être eux-mêmes vivants (Lederberg, 1993 ; van Regenmortel, 2016). Malgré leur rôle central dans l'évolution—particulièrement dans le transfert horizontal de gènes—les virus ne répondent pas aux critères de la vie en raison de leur manque d'indépendance métabolique et de structure cellulaire. Leur influence sur la diversité génétique et les voies évolutives est indéniable, mais ils restent en dehors de la catégorie des organismes vivants (Mindell, 2013 ; Puigbò et al., 2013). La métaphore de l'Arbre de la Vie (ToL) est centrale en biologie évolutive. Les virus compliquent le ToL en raison de leurs interactions génétiques avec les organismes vivants. Cependant, leur incapacité à répondre aux critères fondamentaux de la vie empêche leur inclusion en tant qu'entités vivantes, illustrant la nécessité de modèles qui reconnaissent leur rôle sans les classer comme vivants (Moreira & Lopez-Garcia, 2009 ; van Regenmortel, 2016).
Reconnaissant cela, nous revenons à la perspective du biologiste : les virus, bien qu'essentiels pour comprendre les dynamiques génétiques et évolutives, manquent de métabolisme indépendant, de structure cellulaire et de reproduction non parasitaire. Les futurs modèles évolutifs devraient inclure les virus en tant que facteurs biologiques influents mais pas en tant qu'organismes vivants, à moins que des données empiriques ne nécessitent une redéfinition fondamentale. En conclusion, selon les critères biologiques actuels et les considérations philosophiques, les virus ne qualifient pas comme des organismes vivants. Cette position s'aligne avec le consensus scientifique et les définitions pratiques, maintenant la cohérence dans l'étude de la vie. Il ne s'agit pas d'avoir raison ou tort, mais de travailler dans un cadre conceptuel fonctionnel qui permet aux biologistes d'enquêter, de catégoriser et de comprendre la vie de manière significative.

1,85K
Meilleurs
Classement
Favoris


